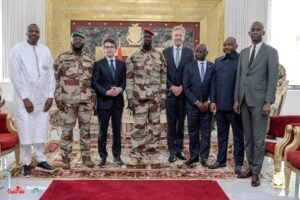Le projet de nouvelle Constitution guinéenne est censé encadrer de manière pérenne la gestion des ressources naturelles du pays. La Guinée, exceptionnellement riche en ressources naturelles, fait face à des défis majeurs : protéger l’environnement, préserver les droits environnementaux des populations, attirer des investissements, garantir la souveraineté nationale sur ses ressources naturelles et assurer une juste répartition des bénéfices. L’objectif de cette analyse est de dégager la portée, les limites et les implications des dispositions proposées en lien avec les ressources naturelles.
Une approche globale de la protection de l’environnement
Si le droit à un environnement sain est consacré (A), la protection des écosystèmes est constatée comme un engagement fort de l’État (B).
Le droit à un environnement sain : un droit consacré
L’article 30 du projet de la nouvelle constitution prévoit un droit fondamental à un « environnement sain ». C’est une reconnaissance juridique importante qui aligne la Guinée avec des standards internationaux comme ceux de la Déclaration de Rio (1992) et de l’Agenda 2030 pour le développement durable. Ce droit est un levier essentiel pour les citoyens.
L’énoncé du droit de toute personne à un environnement sain constitue un acquis juridique et un principe fondamental en matière de protection de l’environnement. Ce droit, inscrit dans le projet de la nouvelle Constitution, s’inscrit dans une vision universelle et est conforme aux normes internationales en matière de droits humains et de protection de l’environnement. L’État s’engage ainsi à garantir la qualité de vie et la préservation des écosystèmes pour les générations présentes et futures.
Cela reflète une avancée significative pour la Guinée, qui pourrait se positionner comme un modèle en matière de législation environnementale dans la sous-région. En consacrant ce droit dans la Constitution, le pays reconnaît formellement la nécessité d’une action forte contre la dégradation des ressources naturelles et les menaces environnementales, tout en établissant un cadre légal pour leur protection.
L’engagement de l’État pour la protection des écosystèmes
L’article 30 dispose également que » . …Le transit, l’importation, le stockage, le déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants et tout accord y relatif constituent des crimes imprescriptibles… « . Cette partie est particulièrement forte car elle place la protection de l’environnement à un niveau juridique supérieur. L’imprescriptibilité des crimes environnementaux est un mécanisme juridique puissant. Elle constitue une garantie contre les abus environnementaux qui pourraient compromettre le futur écologique de la Guinée.
L’article 30 prévoit une série de mesures concrètes pour la sauvegarde de différents éléments essentiels de l’environnement guinéen, tels que la faune, la flore, les cours d’eau, les parcs naturels et les zones humides. Ces écosystèmes constituent des ressources naturelles d’une importance capitale, tant pour la biodiversité que pour les communautés locales.
L’État est ainsi tenu d’agir en protecteur de ces ressources naturelles, en veillant à leur conservation contre les abus et la dégradation. Ce principe de responsabilité publique pourrait favoriser une prise en charge proactive des enjeux environnementaux, ce qui est essentiel dans un contexte où la Guinée, comme de nombreux autres pays, fait face à des défis liés à la déforestation, la pollution de l’air et de l’eau, et la perte de biodiversité.
Le principe de la propriété et de la souveraineté de l’État sur les ressources naturelles : Un déficit de reconnaissance formelle de la propriété de l’État
La souveraineté permanente de l’Etat sur les ressources naturelles est fondamentale (A). C’est à cet effet que la gouvernance des ressources naturelles et la répartition des bénéfices est un gage d’affectation des revenus aux générations futures (B).
La notion de souveraineté permanente sur les ressources naturelles.
Cette partie est la pierre angulaire de toute la régulation des ressources naturelles. Le projet de Constitution doit affirmer de manière indubitable le contrôle de l’État sur ses richesses. 𝐈𝐥 𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐦𝐩é𝐫𝐚𝐭𝐢𝐟 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐝è𝐬 𝐬𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞𝐬, 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐞 𝐪𝐮𝐞 « 𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢é𝐭é 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐞 𝐥’É𝐭𝐚𝐭 𝐠𝐮𝐢𝐧é𝐞𝐧 ». Cette formulation est cruciale. Elle pose un monopole de l’État sur la titularité des ressources, distinguant clairement le domaine public et le domaine privé. En droit, cela signifie que l’État ne peut pas se dessaisir de la propriété des ressources, mais seulement concéder des droits d’exploitation à des tiers, par le biais de titres comme le cas des titres miniers ou d’hydrocarbures. C’est une garantie fondamentale contre la privatisation pure et simple des richesses nationales.
Ce concept, bien que découlant de la propriété, est plus large. Il ne se limite pas à un droit de propriété, mais englobe le « droit inaliénable de chaque État à disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles ». Il s’agit du pouvoir de l’État de fixer les règles du jeu : fiscalité, normes environnementales, clauses de contenu local, etc. C’est le fondement de la politique minière et pétrolière.
Le projet doit encadrer les modalités d’exploitation. Un article doit prévoir que l’État « 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥’𝐢𝐧𝐭é𝐫ê𝐭 𝐬𝐮𝐩é𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐩𝐞𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐠𝐮𝐢𝐧é𝐞𝐧 ». Cela impose une obligation de résultat à l’État.
La gouvernance des ressources naturelles et la répartition des bénéfices : L’affectation des revenus aux générations futures.
Le projet pourrait prévoir la création d’un « fonds souverain pour les générations futures ». Un article pourrait stipuler que « une partie des revenus tirés des ressources naturelles non renouvelables est affectée à un fonds d’investissement à long terme, dont la gestion est transparente et encadrée par la loi ». Cela inscrit la gestion des ressources naturelles dans une perspective de développement durable. C’est une obligation juridique vis-à-vis des générations futures, qui n’auraient pas accès à ces ressources. Cela est juridiquement une limitation au pouvoir discrétionnaire du gouvernement d’utiliser l’intégralité des revenus extractifs pour des dépenses courantes.
Bien que l’article 30 reconnaisse l’importance de la protection de l’environnement, il ne fait pas mention explicite des ressources naturelles comme d’un bien commun. En effet, un tel ajout aurait permis d’établir un lien direct entre la gestion des ressources naturelles et l’intérêt général de la nation et des générations futures. Cette omission pourrait constituer une lacune majeure, car elle prive l’article d’un principe fondamental de droit international et de droit comparé : celui de la gestion responsable et équitable des ressources naturelles au profit de tous.
Conclusion
Le projet de constitution de la République de Guinée présente une volonté manifeste de protéger l’environnement et de préserver les ressources naturelles du pays. Cependant, plusieurs éléments clés manquent pour en faire un instrument de gestion durable et équitable des ressources naturelles. En particulier, l’absence de mention du caractère commun des ressources naturelles. La Guinée, pour garantir une gestion durable de ses ressources naturelles, pourrait intégrer dans sa législation constitutionnelle des principes qui allient préservation environnementale, gestion collective des ressources et exploitation responsable, dans une perspective de développement inclusif et respectueux de l’environnement. Ainsi, elle pourrait alors devenir un modèle de « constitutionnalisme environnemental » pour la sous-région et le continent.
Saa Pascal TENGUIANO, Juriste spécialiste en droit des ressources naturelles.